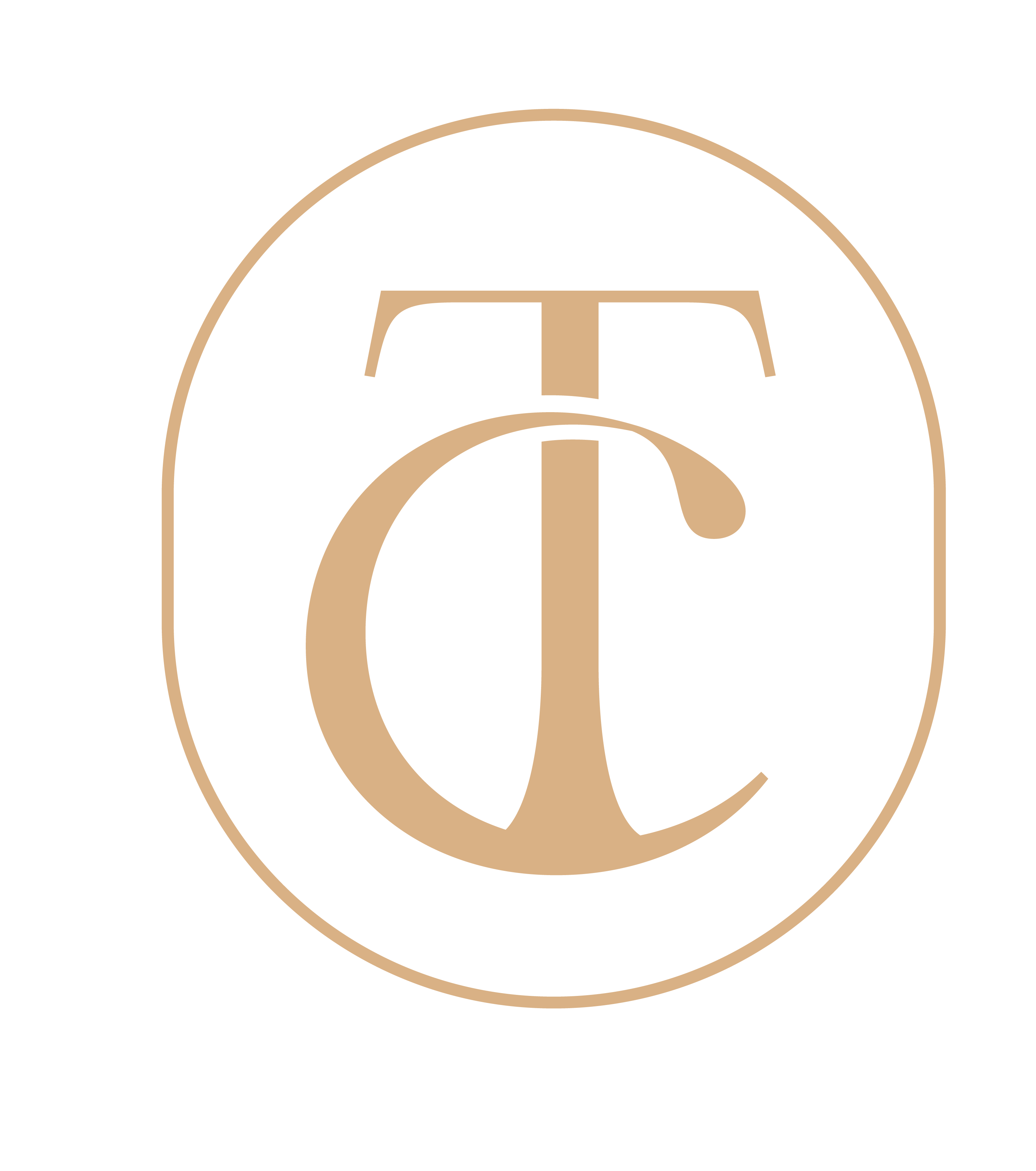Chaque année, de nombreux piétons sont victimes d’accidents de la route. Vulnérables face aux véhicules terrestres à moteur, ils subissent souvent des dommages corporels graves. Heureusement, la loi Badinter prévoit un régime protecteur permettant une indemnisation accélérée et efficace des victimes.
Mais attention, les assureurs ne jouent souvent pas le jeu, et il est indispensable de connaître ses droits. En effet l’assureur doit respecter des obligations strictes, pour que l’indemnisation soit rapide et complète, sous peine de sévères pénalités financières au profit de la victime de l’accident de la route.
Cadre juridique, conditions d’indemnisation, étapes à suivre : découvrez les 7 informations essentielles à connaître pour tout piéton victime d’un accident de la route.

1. La loi Badinter : un régime ultra protecteur pour le piéton victime d’un accident de la route
Adoptée en 1985, la loi Badinter vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Cette loi repose sur un principe fondamental : protéger les victimes non conductrices en leur garantissant une réparation quasi automatique de leurs préjudices corporels.
Si vous êtes victime d’un accident de la circulation, ce n’est pas forcément votre propre assureur qui vous indemnisera.
2. Victime d’un accident de la route : l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident de la route
Pour qu’un piéton soit indemnisé via la loi Badinter, il faut que l’accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, camion, etc.). L’implication ne signifie pas nécessairement un contact direct : un piéton qui chute en voulant éviter un véhicule est aussi concerné. La jurisprudence admet une définition très large de l’implication, ce qui permet d’élargir la protection des victimes.
Les piétons bénéficient d’une protection juridique très renforcée. Sauf faute inexcusable de leur part (très rarement retenue), ils ont droit à une indemnisation intégrale de leurs dommages corporels.
Une faute inexcusable est une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Les juges ne retiennent que très rarement une telle faute à l’encontre de la victime, donc celle-ci est presque toujours automatiquement indemnisée en cas d’accident de la route.
Par exemple il a été jugé que la faute du cycliste, qui circulait sur une route départementale de nuit sans dispositif d’éclairage, n’était pas inexcusable, donc que son droit à indemnisation était total malgré ce comportement. (Civ.2, 28 mars 2019, n°18-14.125)
Si le piéton ou le passager victime d’un accident de la circulation est âgé de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, ou était invalide à plus de 80% au moment de l’accident, alors il est indemnisé automatiquement. Et ce quelque soit son comportement, même s’il a commis une faute inexcusable. La seule exception est s’il a volontairement recherché le dommage (tentative de suicide par exemple).
3. Victime d’un accident de la route : quels sont les préjudices indemnisables ?
Les victimes d’accident de la circulation peuvent prétendre à l’indemnisation de plusieurs types de préjudices :
- Préjudices patrimoniaux (ou préjudices économiques) : frais médicaux, perte de revenus, aménagement du logement, aménagement du véhicule, besoins d’aide humaine, incidence professionnelle, etc
- Préjudices extrapatrimoniaux (ou préjudices moraux) : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel permanent et temporaire, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, etc.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les différents préjudices indemnisables
Le plus souvent, afin de lui permettre d’évaluer les préjudices pour ensuite faire son offre, l’assureur va proposer à la victime d’être examinée par un médecin, afin que ce dernier rende un rapport d’expertise qui servira de base pour calculer l’indemnisation.
Cependant ce médecin est celui de l’assureur. Il n’est pas neutre et impartial, mais travaille pour la compagnie d’assurance qui le mandate, et est rémunéré par celle-ci. Cette compagnie a bien sûr des intérêts opposés à ceux des victimes, dont elle cherchera toujours à réduire l’indemnisation.
Il est toutefois possible pour la victime de se rendre accompagnée à cette expertise, par un médecin conseil de son choix et par son avocat spécialisé en dommage corporel. Il est également possible que l’avocat de la victime s’accorde avec l’assureur pour que l’expertise soit réalisée par deux médecins, celui de l’assureur et celui choisi par la victime, afin que la balance soit rééquilibrée.
Enfin, il est possible de refuser que le médecin de l’assureur réalise l’expertise médicale, et de demander à un juge de nommer un médecin expert neutre et indépendant. Dans ce cas le délai imparti à l’assureur pour faire une offre est rallongé d’un mois.
Cliquez ici ou ici pour en savoir plus sur l’expertise médicale
4. Victime d’un accident de la route : la procédure d’offre amiable qui s’impose à l’assureur

Différents délais s’imposent à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation.
– L’assureur du véhicule impliqué doit formuler une offre d’indemnisation dans les 8 mois suivant l’accident, conformément à la loi Badinter.
Cette offre d’indemnisation peut être provisionnelle (c’est-à-dire que les sommes versées ne sont qu’une avance sur l’indemnisation finale) si la victime n’est pas consolidée (c’est-à-dire si son état est encore susceptible de modifications) dans les trois mois suivant l’accident.
Si l’assureur n’a pas été informé de l’accident dans le délai d’un mois après sa survenance, ce délai de huit mois est alors suspendu, et recommence à courir dès le jour où l’assureur obtient cette information
– L’assureur est obligé de formuler une offre d’indemnisation à la victime dans les 5 mois suivant le jour où il est informé de sa consolidation (date où l’état de santé n’est plus susceptible de modifications).
– Si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage a été entièrement évalué, l’assureur doit faire une offre à la victime, si cette dernière le lui réclame, dans les 3 mois suivant cette demande.
Si ces différents délais s’imbriquent, le plus favorable à la victime s’appliquera toujours.
Pour faire son offre, l’assureur doit parfois demander certains éléments au piéton victime de l’accident de la circulation, comme :
- Eléments d’identité
- Activité professionnelle et identité de l’employeur
- Montants des revenus professionnels avec justificatifs
- Description des atteintes à subies,
- Certificat médical initial
- Coordonnées des personnes à charge
- Numéro de sécurité sociale
- Identité des éventuelles mutuelles ou assurances ayant versé des sommes en raison de l’accident
- Etc.
Cliquez ici pour encore plus de précisions sur cette procédure d’offre d’indemnisation
5. Victime d’un accident de la route : les sanctions pour l’assureur en cas de non-respect des délais ou d’offre d’indemnisation insuffisante
Si l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus (8 mois, 5 mois, 3 mois) ou propose une offre d’indemnisation manifestement insuffisante, il peut être lourdement sanctionné financièrement.
Cette sanction est la suivante : l’assureur doit verser à la victime une somme supplémentaire correspondant aux intérêts de l’indemnité, au double du taux légal. Par exemple, au second semestre 2024, cela représente un taux de 16,32% !
Dans certains dossiers, cette pénalité peut représenter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros.
En pratique il n’est pas rare que les assureurs soient condamnés à cette pénalité, en raison d’offres trop tardives, ou d’offres incomplètes ou insuffisantes qui équivalent à une absence d’offre.
Il est donc indispensable pour la victime d’un accident de la route de s’interroger sur ces éléments.
En effet la loi lui est très favorable sur cette question, mais encore faut-il bien en connaître les nombreux mécanismes et savoir la pratiquer, afin d’analyser chaque délai et chaque montant indemnitaire proposé.
Cela permettra d’étudier la possibilité de recourir à un juge et de lui demander d’appliquer cette sanction financière, mais également de se trouver en position de force dans les négociations amiables avec l’assureur.
Cliquez ici pour en savoir plus sur cette procédure et ces sanctions financières
6. Victime d’un accident de la route : l’intervention du FGAO si le conducteur a pris la fuite ou n’est pas assuré
Si le conducteur responsable prend la fuite ou n’est pas assuré, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) prend en charge l’indemnisation des victimes, conformément à l’article L. 421-1 du Code des assurances.
Dans ce cas il faut agir rapidement, car la demande doit être adressée au FGAO dans certains délais, à savoir :
- 1 an maximum après l’accident si les dommages ne sont que matériels
- 3 ans maximum après l’accident pour les dommages corporels, si le conducteur impliqué n’a pas pu être identifié
- 1 an maximum après l’accident pour les dommages corporels, si le conducteur impliqué est connu mais n’est pas assuré
Attention : Si la demande n’est pas déposée dans ces délais, l’indemnisation peut être refusée.
Le FGAO peut être saisi très facilement, par l’envoi d’un formulaire en lettre recommandée.
Il n’est pas obligatoire d’être assisté par un avocat, mais cela est vivement recommandé, car il est évident que s’engager seul dans une procédure aussi complexe est une très mauvaise idée.
Le FGAO est soumis à la même procédure que les assureurs, et doit faire des offres financières suffisantes, dans les délais légaux, sous peine de lourdes sanctions économiques.
Cliquez ici pour en savoir plus sur le fonctionnement du FGAO
7. Victime d’un accident de la route : quels sont les bons réflexes ?
Si vous êtes victime de dommages corporels à la suite d’un accident de la route, voici quelques bons réflexes à adopter :
- Appeler immédiatement la police ou la gendarmerie puis déposer plainte et obtenir une copie des procès-verbaux d’enquête
- Etablir un constat amiable si possible
- Prendre des photos de la scène et recueillir des témoignages si possible
- Consulter un médecin rapidement pour faire constater vos blessures
- Obtenir une copie intégrale de votre dossier médical
- Consulter dès que possible un avocat spécialisé en dommages corporels pour défendre vos droits
- Saisir l’assureur du véhicule ou le FGAO rapidement et transmettre un dossier complet
Conclusion
Si vous êtes victime de dommages corporels à la suite d’un accident de la route, voici quelques bons réflexes à adopter :
L’indemnisation d’un piéton victime d’un accident de la route est rendue presque automatique par la loi Badinter.
Mais les assureurs ou le FGAO cherchent souvent à limiter au maximum les indemnisations des victimes.
Il ne faut donc certainement pas les voir comme des alliés ou des partenaires, leurs intérêts sont totalement opposés à ceux des victimes.
L’assureur ou le FGAOparviendra facilement à limiter le coût de l’indemnisation qu’il devra verser, voire à refuser de la verser, lorsque la victime ignore ses droits, ne maîtrise pas la procédure, et se trouve dans une situation de solitude, de détresse et d’épuisement en raison de l’accident et des nombreuses démarches parallèles à réaliser.
Par conséquent, faire appel à un avocat spécialisé en dommages corporels est essentiel pour obtenir une indemnisation juste, complète et beaucoup plus favorable, afin de réparer l’ensemble des préjudices moraux et corporels. Victimes d’accidents de la route : ne laissez pas votre indemnité être sous-évaluée par vos adversaires, faites valoir vos droits avec l’aide d’un professionnel du droit maîtrisant parfaitement les procédures et les techniques d’indemnisation.